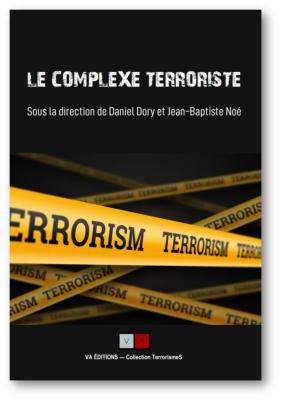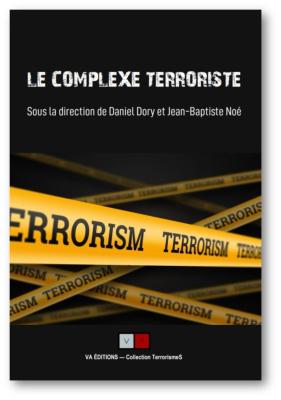Parmi les nombreuses missions dont se sentent investis nos journalistes, il en est une qu’ils assument avec une application particulière ces derniers temps : la lutte contre le complotisme. Ils ont de cette notion une définition très extensive puisque relève du complotisme, selon eux, toute remise en cause de la thèse officielle.
Étonnez-vous du surgissement opportun des révélations qui ont conduit à ce scandale qu’il est convenu d’appeler le Pénélopegate : vous êtes complotiste. À la vérité, les journalistes devraient toujours être les premiers à s’interroger, à froncer un sourcil sceptique devant tout événement qui arrive trop évidemment à point nommé. Mais ils ne s’étonnent jamais, pis, ils s’interdisent de s’étonner. Ils ont tacitement accepté d’être manipulés et c’est, à mon sens, un tournant grave dans la conception même que se font de la presse ses principaux acteurs.
Mais il est un événement face auquel ils se sont sentis autorisés à adopter une posture critique qui correspond exactement à ce qu’ils dénoncent habituellement comme du complotisme. Je veux parler de l’attentat de Saint-Pétersbourg. Le 3 avril 2017, une bombe dans le métro de cette grande ville russe faisait 14 morts et une cinquantaine de blessés. Une semaine plus tôt, la Russie était déjà visée : six soldats mouraient dans une attaque de djihadistes visant la base militaire de Grozny, en Tchétchénie. Nous ne l’apprîmes qu’au détour d’une phrase, ici et là, dans les articles traitant de l’attentat de Saint-Pétersbourg. Mais surtout, ce qui ne manqua pas de troubler un certain nombre d’observateurs du discours médiatique, c’est la différence de traitement entre cet attentat et celui du pont de Westminster, moins de quinze jours avant, le 22 mars (un homme avait foncé dans la foule, tuant 5 personnes et en blessant 44 autres).
Les expressions et les mots disent assez la différence d’appréciation qui sous-tend le traitement médiatique de ces deux drames. À Londres, on parle de « terroriste présumé », c’est l’expression juridique consacrée. En revanche, pour parler de l’attaque survenue à Saint-Pétersbourg, l’AFP mentionne un « éventuel terroriste ». La thèse des autorités russes est donc d’emblée mise à distance. Dans le premier cas, on nous dit que « le suspect a été identifié » ; dans le second, qu’un kamikaze kirghiz « est désigné comme l’auteur de l’attentat », ou bien que cet attentat « est attribué à » un kamikaze kirghiz. Là encore, mise en doute implicite, prise de distance avec la parole officielle.
Les journalistes prennent le parti de présenter l’attentat en Russie comme une chance pour Poutine : l’occasion, dans une période difficile, de réaffirmer son autorité. Theresa May non plus n’était pas en bonne posture, comme le confirmèrent les résultats des élections législatives. Pourtant, l’attaque près du Parlement n’est pas présentée comme une opportunité, mais comme un événement qui « fragilise » son pouvoir. Cette grille de lecture semble lui être défavorable. Mais en réalité, elle l’exonère d’une suspicion que, dans le même temps, on s’évertue à faire peser lourdement sur le Président russe. Si ce dernier peut espérer tirer profit de l’attaque terroriste, peut-être est-ce parce qu’il en est l’organisateur. À force d’insinuations et d’hypothèses, voilà bien l’interprétation des faits qui s’impose. Savoir si un attentat est bon ou mauvais pour le pouvoir en place est un petit jeu médiatique contestable. Alors que la France subissait des attaques, mois après mois, François Hollande semblait dépassé et impuissant. Mais les commentateurs jugeaient que ces drames lui étaient bénéfiques et saluaient sa carrure de « chef de guerre » !
La revendication de l’attentat de Saint-Pétersbourg par un groupe agissant sur instruction d’Al-Qaida passera totalement inaperçue, réduite à un petit entrefilet en bas de page ou à une phrase défilante dans le bandeau des chaînes d’information continue. Les Russes n’auront pas nos larmes.
Étonnez-vous du surgissement opportun des révélations qui ont conduit à ce scandale qu’il est convenu d’appeler le Pénélopegate : vous êtes complotiste. À la vérité, les journalistes devraient toujours être les premiers à s’interroger, à froncer un sourcil sceptique devant tout événement qui arrive trop évidemment à point nommé. Mais ils ne s’étonnent jamais, pis, ils s’interdisent de s’étonner. Ils ont tacitement accepté d’être manipulés et c’est, à mon sens, un tournant grave dans la conception même que se font de la presse ses principaux acteurs.
Mais il est un événement face auquel ils se sont sentis autorisés à adopter une posture critique qui correspond exactement à ce qu’ils dénoncent habituellement comme du complotisme. Je veux parler de l’attentat de Saint-Pétersbourg. Le 3 avril 2017, une bombe dans le métro de cette grande ville russe faisait 14 morts et une cinquantaine de blessés. Une semaine plus tôt, la Russie était déjà visée : six soldats mouraient dans une attaque de djihadistes visant la base militaire de Grozny, en Tchétchénie. Nous ne l’apprîmes qu’au détour d’une phrase, ici et là, dans les articles traitant de l’attentat de Saint-Pétersbourg. Mais surtout, ce qui ne manqua pas de troubler un certain nombre d’observateurs du discours médiatique, c’est la différence de traitement entre cet attentat et celui du pont de Westminster, moins de quinze jours avant, le 22 mars (un homme avait foncé dans la foule, tuant 5 personnes et en blessant 44 autres).
Les expressions et les mots disent assez la différence d’appréciation qui sous-tend le traitement médiatique de ces deux drames. À Londres, on parle de « terroriste présumé », c’est l’expression juridique consacrée. En revanche, pour parler de l’attaque survenue à Saint-Pétersbourg, l’AFP mentionne un « éventuel terroriste ». La thèse des autorités russes est donc d’emblée mise à distance. Dans le premier cas, on nous dit que « le suspect a été identifié » ; dans le second, qu’un kamikaze kirghiz « est désigné comme l’auteur de l’attentat », ou bien que cet attentat « est attribué à » un kamikaze kirghiz. Là encore, mise en doute implicite, prise de distance avec la parole officielle.
Les journalistes prennent le parti de présenter l’attentat en Russie comme une chance pour Poutine : l’occasion, dans une période difficile, de réaffirmer son autorité. Theresa May non plus n’était pas en bonne posture, comme le confirmèrent les résultats des élections législatives. Pourtant, l’attaque près du Parlement n’est pas présentée comme une opportunité, mais comme un événement qui « fragilise » son pouvoir. Cette grille de lecture semble lui être défavorable. Mais en réalité, elle l’exonère d’une suspicion que, dans le même temps, on s’évertue à faire peser lourdement sur le Président russe. Si ce dernier peut espérer tirer profit de l’attaque terroriste, peut-être est-ce parce qu’il en est l’organisateur. À force d’insinuations et d’hypothèses, voilà bien l’interprétation des faits qui s’impose. Savoir si un attentat est bon ou mauvais pour le pouvoir en place est un petit jeu médiatique contestable. Alors que la France subissait des attaques, mois après mois, François Hollande semblait dépassé et impuissant. Mais les commentateurs jugeaient que ces drames lui étaient bénéfiques et saluaient sa carrure de « chef de guerre » !
La revendication de l’attentat de Saint-Pétersbourg par un groupe agissant sur instruction d’Al-Qaida passera totalement inaperçue, réduite à un petit entrefilet en bas de page ou à une phrase défilante dans le bandeau des chaînes d’information continue. Les Russes n’auront pas nos larmes.